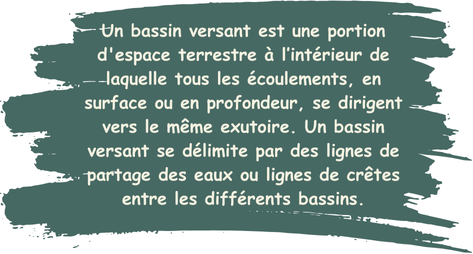Le bassin versant du Viaur

Le bassin hydrographique du Viaur
Le bassin versant du Viaur est inclus dans le bassin Tarn Aveyron, ensemble appartenant au grand bassin Adour Garonne. Le bassin versant du Viaur s’étend sur une longueur de 70 km pour une largeur d’environ 20 km soit une superficie de 1 561 km².
Situé au Sud de Rodez et au Nord-Ouest de Millau, son bassin versant recouvre 68 communes Aveyronnaises, 16 communes Tarnaises et une commune Tarn et Garonnaise soit au total 85 communes regroupées en 14 EPCI-FP tous adhérents à l’EPAGE Viaur.
Le Viaur, affluent rive gauche de l’Aveyron, prend sa source au sud du Puech Del Pal sur la commune de Vézins du Lévezou, à une altitude de 1090 mètres. Il serpente d’Est en Ouest, à travers deux grandes régions naturelles : le Lévezou et le Ségala. Après un parcours de 168 kilomètres, il conflue avec l’Aveyron à Saint Martin Laguépie (département du Tarn) et Laguépie (département du Tarn et Garonne) à une altitude de 150 m.
Caractéristiques générales
Pour plus de détails : voir les documents constitutifs du "Contrat de Rivière Viaur III" :
Le territoire ; contexte humain et économique :
- Le bassin versant est composé de nombreux petits cours d’eau : 110 cours d’eau nommés pour un réseau hydrographique total d’environ 3500 km source BD Topo.
- La pluviométrie annuelle varie de 1 200 mm sur le Lévézou à 800 mm sur le Ségala.
- 37 % du territoire présente des pentes supérieures à 15 %.
- Pas de nappe d’accompagnement mais un fonctionnement « alluvial » sur la partie aval ; la ressource en eau provient d’un aquifère de fracturation, de nappes perchées et des zones humides.
- Habitat peu dense et dispersé ; territoire peu peuplé : 22 habitants au km² avec une densité plus élevée sur le secteur aval. Population estimée sur le bassin versant 34 402 habitants population légale au 01.01.2023 (population 2020).
- Territoire à forte vocation agricole : 76 % de l’espace est consacré à l’agriculture.
- Forte empreinte de l’usage hydroélectrique : 384 km² du bassin amont sont impactés et de grands linéaires sont soumis à un débit réservé sur les axes principaux du Viaur et du Vioulou.( Complexe hydroélectrique du Pouget).
- Deux grands axes routiers structurent le territoire : RN 88 et D 911.
- Peu d’activités industrielles.
- Activités touristiques concentrées sur les deux mois d’été et localisées pour leur majorité autour des grands lacs du Lévézou.


Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique du bassin versant s’organise autour de la rivière principale et de ses « grands affluents » de l’amont vers l’aval :
- Le Viaur (longueur 168 km )
- le Varayous en rive droite (longueur 11 km)
- le Vioulou en rive gauche (longueur 33,7 km dont 8.9 km correspondent à la retenue de Pareloup)
- la Nauze en rive droite (longueur 15.7 km)
- le Céor (longueur 49.2 km) et son affluent le Giffou (longueur 47.5 km) en rive gauche
- le Lieux du Viaur (ou Tieux) en rive droite (longueur 24.4 km)
- le Lézert (37.6 km) et ses affluents : Lieux de Villelongue (19.7km) et le Liort (18.4km) en rive droite
- le Jaoul (longueur 23.1 km) et son affluent le Vemhou (14.5 km) en rive droite
On recense ainsi dans le bassin du Viaur, plus de 3500 km de cours d’eau (source BD Topo) .
Caractéristiques naturelles
Climatologie, pluviométrie, température
Le Viaur est orienté d’Est en Ouest de Vezins de Lévezou à Bonnecombe ; il prend ensuite une orientation Sud puis traverse d’Est en Ouest la région naturelle du Ségala. Les altitudes varient entre 400 et 800 m pour les parties occidentales et septentrionales du bassin et de 800 à 1200 m pour les parties orientales. Au relief vallonné de la région naturelle du Lévezou succèdent les plateaux allongés entaillés par les profondes vallées du Ségala. D’après la courbe hypsométrique, 50 % de la surface du bassin versant du Viaur se situe à une altitude supérieure à 600 m.
A l’Est du bassin versant, sur toute la frange Nord, une crête sépare le bassin versant du Viaur et le bassin versant de l’Aveyron. Cette dorsale crée une barrière climatique et se trouve sensiblement plus arrosée que la partie Sud du bassin. Les précipitations sont fortes, la moyenne annuelle est de 1000 à 1200 mm sur le Lévezou et 800 à 900 mm sur le Ségala.
Le bassin versant du Viaur se caractérise par plusieurs influences climatiques qui en font sa diversité et son charme. Ce territoire se situe aux confins du bassin Aquitain, du massif central et est proche de la région méditerranéenne ce qui en fait un carrefour bioclimatique où viennent se rencontrer les influences atlantiques, océaniques, montagnardes et méditerranéennes. Les conditions climatiques sont caractéristiques d’un climat à dominante océanique avec une influence montagnarde sur le Lévezou du fait de l’altitude : La température moyenne est voisine de 12°C à l’Ouest (moyenne annuelle de 11,4°C à Quins) et s’abaisse en dessous de 9 °C à l’Est (moyenne annuelle de 8,8°C à Salles Curan).
Relief, Géologie, Climat : les facteurs abiotiques
Véritable carrefour bioclimatique, le bassin versant du Viaur se situe au point de rencontre de plusieurs grands domaines biogéographiques. Sa localisation aux confins du bassin Aquitain, sur le contrefort méridional du Massif Central et à proximité de la région méditerranéenne permet en effet la convergence des influences atlantique, montagnarde et méditerranéenne. L’orientation Est-Ouest de la vallée favorise à la fois la pénétration de l’influence atlantique ainsi que la différenciation d’un versant orienté plein Sud avec un autre, moins exposé, car tourné vers le Nord.
Cette diversité s’exprime également au travers de la géomorphologie du territoire, avec une altitude culminant à plus de 1150 mètres à la source du Viaur au Puech del Pal, pour atteindre 150m au niveau de la confluence avec l’Aveyron. Le bassin versant présente des variations de pentes importantes, avec des plateaux au relief doux au niveau des secteurs amont, contrastant avec des vallées encaissées aux versants parfois abrupts. La combinaison des influences et du relief se traduisent par un gradient Est-Ouest de température et de pluviométrie. A l’amont du bassin versant, la pluviométrie moyenne dépasse les 1100mm pour une température moyenne inférieure à 10°C. Plus à l’Ouest, vers l’aval, les précipitations moyennes annuelles sont plus proches de 900mm, voir en deçà localement, alors que la température moyenne est plutôt de 12°C. Enfin, la géologie est également un facteur exerçant une influence marquée. Le bassin versant est dominé par un substratum schisto-gneissique qui confère aux sols une certaine acidité et une relative pauvreté en éléments nutritifs, surtout sur les versants. On notera cependant la présence, au niveau de la bordure orientale du bassin versant, des insertions calcaires (grès et marnes) qui exercent une influence originale, bien que très localisée, sur les milieux naturels.
Sur le Lévezou, nous retrouvons principalement des massifs sur gneiss situés entre 600 et 1200 mètres d’altitude (UC 39). Les sols y sont souvent acides à très acides, riches en matière organique, à dominante sablo-limoneuse. « L’érosion est aussi très importante avec, en particulier, formation de sols bruns acides peu profonds et de sols superficiels (rankers). » et des hautes collines et monts situés entre 600 et 1100 mètres d’altitude sur schistes et micashistes (UC 38). Les sols sont le plus souvent bruns acides, riches en matière organique, limoneux, plus ou moins caillouteux, peu ou moyennement profonds. « Le relief accidenté entraîne une érosion importante dans de très nombreuses zones avec formation, en particulier, de sols peu évolués (rankosols). »
Sur le Ségala, nous sommes sur des Plateaux et collines de 300 à 600/700m d’altitude (UC 36), souvent fortement entaillés par les cours d’eau et leurs affluents. Les sols sur schistes sont le plus souvent limoneux, caillouteux, acides, moyennement profonds.
Tout comme la pente, le type de sol est un élément très important de l’appréciation de l’érosion sur le territoire.
Les espaces : région naturelles et habitats
La combinaison de ces facteurs abiotiques permet, au sein du bassin du Viaur, la présence de deux régions naturelles bien individualisées : Ségala et Lévézou.
- A l’amont du bassin, le Lévézou se présente sous la forme d’un vaste plateau au relief moutonneux, principalement traversé par le Viaur et le Vioulou. Il s’agit d’un ensemble métamorphique hercynien relevé par l’Est lors de la formation de la chaîne alpine. L’étymologie est ici équivoque quant au rôle de « château d’eau » joué par ce territoire, « Lévézou » se traduisant comme la « source des èves », donc la « source des eaux ». Le réseau hydrographique, de même que le paysage, a été profondément modifié au tournant des années 50 par la construction des retenues hydroélectriques du complexe du Pouget (Pont de Salars, Bage, Pareloup). Les caractéristiques abiotiques de ce territoire contribuent à la présence d’un vaste réseau de zones humides, localement tourbeuses, donnant naissance à un nombre important de cours d’eau. Le complexe humide du Lévézou, bien qu’autrefois vraisemblablement beaucoup plus étendu, abrite aujourd’hui encore plusieurs habitats et espèces (faune et flore) à fort enjeu de conservation. Sur les versants, ces ensembles humides laissent la place à des landes acidiphiles et des pelouses oligotrophes. De manière plus générale, les milieux agricoles non artificialisés et bénéficiant de longue date d’une gestion extensive, comportent des formations prairiales ou pelousaires également remarquables en termes de richesse spécifique. Ces formations font partie intégrante de l’identité du Lévézou qui porte une responsabilité certaine dans la conservation de ce type d’habitat. Ces espaces ont fortement régressé sous la pression de l’agriculture, aujourd’hui omniprésente et qui occupe près de 80% du territoire. Les espaces boisés sont dominés par le Hêtraie, en situation climacique, même si de vastes surfaces ont été consacrées depuis les années 60 à la production sylvicole.
- A l’Ouest, donc vers l’aval, on progresse vers le Ségala, région naturelle moins élevée que le Lévézou. Cette région tire son nom de la pauvreté de ses sols qui n’autorisait historiquement que la culture du seigle. L’ambiance paysagère se structure autour d’une trame bocagère occupant des plateaux régulièrement découpés par des profondes vallées. Les paysages ont également été fortement modifiés par l’avènement de l’agriculture moderne, les apports d’amendements calciques et la mécanisation ayant permis la mutation vers des systèmes agricoles plus intensifs. A contrario, cette évolution a conduit au délaissement des versants pentus et des fonds de vallées, moins accessibles, qui présentent aujourd’hui un caractère relativement sauvage.
à télécharger
Les espèces, la Biodiversité :
Maître mot « Diversité »
- La diversité du bassin du Viaur constitue une grande richesse : on y rencontre des espèces méditerranéennes comme des espèces montagnardes. Et ce tant au niveau des espèces faunistiques que floristiques,
- La présence d’espèces patrimoniales rares en milieu aquatique (écrevisses à pattes blanches, Moule perlière) nécessitant des précautions particulières : espèces très sensibles aux modifications de leur habitat,
- Les secteurs de gorges très accidentés et difficiles d’accès ont permis de conserver un caractère sauvage et naturel propice à la présence d’espèces rares dont certaines font l’objet de plan nationaux de gestion (faucon pèlerin, grand duc, chiroptères, odonates…).
L'Occupation des sols
D’après l’analyse de l’Occupation des Sols à Grande Echelle (OCSGE) le bassin versant du Viaur comprend 95.8 % de surface aux sols perméables : forêts, arbustes et herbacées dont 70 % sont des surfaces cultivées déclarées à la PAC.
Globalement, le bassin versant du Viaur est un territoire :
- peu peuplé : 22 habitants au km², un habitat dispersé et peu dense,
- à forte vocation agricole : 76 % de l’espace est consacré à l’agriculture,
- avec une forte empreinte de l’usage hydroélectrique : 384 km² du bassin amont sont impactés et de grands linéaires sont en débits réservés sur les axes principaux,
- Peu d’activités industrielles,
- Activités touristiques concentrées sur les deux mois d’été et localisées pour leur majorité autour des grands lacs du Lévezou.